Accompagner
DOSSIER : Accompagner pour émanciper

La pauvreté et la précarité sont, rappelle le Secours populaire, une injustice fondamentale et une atteinte à la dignité des hommes, des femmes et des enfants qui la subissent. « Avocat des pauvres », comme a pu le définir son président-fondateur Julien Lauprêtre, le Secours populaire refuse de les réduire à leur condition sociale, encore plus de les stigmatiser ou les culpabiliser.
Il n’y a pas d’« assistés », mais des personnes qui ont, à un moment de leur parcours, besoin de la solidarité populaire dans leur lutte face aux inégalités. C’est à notre humanité commune que l’association fait appel, ainsi qu’aux valeurs d’entraide qui font grandir les êtres humains. Dans la solidarité qu’il met en mouvement, le Secours populaire ne distingue pas celui qui donne de celui qui reçoit : chacun cultive les richesses qu’il porte en lui et fait bénéficier la collectivité de son pouvoir d’agir.
Ce dossier de la rédaction de Convergence propose de déconstruire la notion d’« assistanat » (lire notre DÉCRYPTAGE), qui signe le retour en force de la stigmatisation des pauvres (lire notre PAROLE D’EXPERT : le sociologue Vincent Dubois, spécialiste du système de protection sociale). Le dossier se prolonge par le PORTRAIT de Zouhra Kouam, bénévole du Secours populaire, dont le passage de l’ombre à la lumière pourfend les stéréotypes et incarne cet espoir d’émancipation que le Secours populaire nourrit pour chacune des personnes accueillies au sein de ses permanences d’accueil.
Dossier réalisé par Olivier Vilain et Pierre Lemarchand
DÉCRYPTAGE

L’assistanat, ça n’existe pas
DECRYPTAGE. Prime à la rénovation. Prime à l’apprentissage. Aides à la restauration… Les aides publiques sont très nombreuses, mais seules celles à destination des pauvres, des inactifs, des chômeurs sont qualifiées d’« assistanat ». En accusant les personnes en difficulté de profiter du système, c’est l’idée même de protection sociale qui est visée, comme le montre l’instauration de 15 heures hebdomadaires d’activités pour percevoir le RSA.
Janvier 2025 marque un tournant. Dorénavant, une activité de 15 heures par semaine sera obligatoire pour percevoir le Revenu de solidarité active (RSA), d’un montant de 634,71 euros par mois pour une personne seule. L’entrée en vigueur de cette conditionnalité a alerté la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). Toutes les personnes n’ont, en effet, pas la capacité de travailler durant la totalité de leur vie active, pour de multiples raisons : absence de qualification, problèmes de logement, de transport, de santé, divorce, inadéquation des modes de garde d’enfants en bas âge… Cela ne devrait jamais entraîner une absence de revenus.
Une réalité qui s’est déjà exprimé dans les précédentes éditions des cahiers « Le dire pour agir », une démarche du Secours populaire invitant personnes accueillies, bénévoles, donateurs, amis à s’exprimer sur leur situation et leurs envies, ainsi que sur les actions prioritaires qui permettraient d’inventer « ensemble une action solidaire qui change la donne ». Cette année, les bénévoles du Secours populaire repartent à la rencontre du grand public avec ces cahiers organisés autour de trois thèmes : « dans quelles réalités je vis » ; « ce dont je rêve, les jours heureux » et « ce que nous pourrions faire ».
Je n’ai pas le permis, ça ne m’a jamais empêché de faire les trois-huit.
Près de Nîmes, Pascaline décrit très facilement ses conditions de vie. La quarantaine, elle a contracté une maladie invalidante, il y a plusieurs années, l’obligeant à arrêter ses « heures de ménage ». Même si elle n’a pas abandonné l’espoir de reprendre un jour. Cet été, lors d’une sortie dans les Cévennes, Pascaline rappelait aux bénévoles du Secours populaire avoir commencé à 15 ans par « faire les saisons » : maïs, pommes de terre, cerises « qu’il fallait cueillir avec la petite fleur, avec la queue et au bon calibre, sinon c’était une pénalité »… Elle a aussi travaillé dans la restauration, « même enceinte », et pédalé tous les jours pendant des années pour tenir son poste à l’usine de vins qui l’employait, à une heure de route de son petit village. « Je n’ai pas le permis, ça ne m’a jamais empêché de faire les trois-huit. »
La CNCDH considère que le nouveau dispositif du RSA porte « atteinte aux droits humains » et s’inquiète, tout comme le Conseil économique social et environnemental, de ce que cette transformation cède à « des discours politiques et médiatiques [qui] rendent les personnes précaires responsables de leur situation ». Des discours comme celui d’un ancien député de la Drôme ne voyant dans la protection sociale rien d’autre que le triomphe de la «culture de l’assistanat ». « Assistanat », ce néologisme jette l’opprobre et l’infamie sur le système d’aide sociale – appelé « assistance » par les Pères fondateurs de la République aux 18e et 19e siècles – à travers la stigmatisation de ses « dérives » supposées.

Ce vocable enserre le regard dans le registre de la morale, le détournant des mécanismes socio-économiques de la fabrique des inégalités. « L’aide sociale, une vertu républicaine (…), se retourne parfois en vice – en assistanat. Beaucoup de gens préfèrent (…), par un maniement habile de CDD successifs, profiter des aides sociales plutôt que de s’engager, de manière pérenne, dans une voie professionnelle », certifie l’essayiste Julia de Funès dans un entretien accordé au Figaro,le 26 décembre dernier. Cette morale de l’évidence s’autorise même de l’autorité de la médecine lorsque l’« assistanat » est présenté comme un « cancer de la société française », comme si le tissu social était mis en péril par une prolifération d’abus en tous genres.
Devenu un lieu commun, le thème de l’« assistanat » diffuse le poison du soupçon : pauvres, chômeurs et précaires profiteraient des généreuses prestations financées par les « gens qui se lèvent tôt », selon la formule d’un ancien chef de l’Etat qui jugeait la République « incompatible avec l’assistanat ». À force de répétition, 71 % des Français exprimaient, dans un sondage effectué durant une campagne présidentielle, leur volonté de voir la lutte contre l’« assistanat » devenir une priorité. Cette peur banalisée, selon la formule de Julia de Funès, d’un « retournement de la vertu républicaine de l’aide sociale (…) en assistanat, ce vice à combattre » rend encore plus dure la vie de celles et ceux qui luttent pour maintenir leur tête hors de l’eau.
« Cela vous tombe dessus à n’importe quel moment, dans la rue, en famille… »
Vivant au Puy-en-Velay, Marie a confié à une équipe du Secours populaire un incident survenu à la caisse de la supérette de son quartier. Au RSA à l’époque, elle paie des couches et du lait pour sa fille avec les bons d’achat donnés par une association. Une cliente la désigne alors à ses enfants comme une « profiteuse ». « Cela vous tombe dessus à n’importe quel moment, soupire Marie : dans la rue, en famille… Il n’y a jamais de répit. (…) J’ai eu les larmes aux yeux. Je me sens déjà coupable d’être dans cette situation… »
« Cette situation » dont Marie a honte n’est jamais décrite par le discours qui accuse les « assistés » de vivre aux crochets « des gens qui réussissent ». Ses conditions de vie sont pourtant partagées par 11,2 millions de personnes dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté (1 216 euros par mois pour une personne seule en 2024, selon l’INSEE). Un chiffre auquel il faut ajouter 2 millions de gens environ dont les revenus sont légèrement supérieurs, mais qui souffrent eux aussi de privations matérielles et sociales. « Restrictions, retards de paiement et difficultés de logement [sont] très souvent cités » par les foyers dont l’adulte de référence est au chômage et par les familles monoparentales, relève l’INSEE.

La pauvreté a un impact sur la santé. Les chômeurs comptent parmi les groupes sociaux ayant la plus courte espérance de vie et plus d’un allocataire du RSA sur cinq se dit « en mauvaise ou très mauvaise santé », alors que cette proportion se limite à 8 % dans la population de plus de 16 ans. La « violence alimentaire », selon l’expression forgée par l’anthropologue Bénédicte Bonzi, n’y est sans doute pas pour rien : le droit à l’alimentation n’est pas respecté alors que la nourriture abonde. Les files d’attente s’allongent devant les permanences d’accueil. Rien qu’au Secours populaire, près de 2 millions de personnes viennent car leur réfrigérateur est vide. « Je me rends au Secours populaire sinon je ne pourrais pas manger », témoigne Didier, un retraité qui vit en mobile home dans les Yvelines. Ses revenus dépassent un peu le seuil de pauvreté et il ne lui reste que 200 euros une fois ses charges payées en début de mois.
Cette violence est illustrée par le dernier baromètre Ipsos/Secours populaire : un Français sur trois (32 %) est contraint « parfois ou régulièrement » de ne pas faire trois repas par jour du fait de la hausse des prix des denrées alimentaires. Ce sombre état des lieux coïncide avec l’effondrement des quantités de nourriture achetées l’année dernière ; les statisticiens de l’INSEE n’avaient jamais vu ça.
« Tous les jours, je fais le décompte de ce qu’il me reste (…). »
« Le discours sur l’assistanat néglige les questions qui touchent au droit, à la citoyenneté et à l’égalité », pointe le sociologue Nicolas Duvoux, membre du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (Le Monde, 26.10.17). Se restreindre sur tout, pas que sur l’alimentaire, est le lot des familles qui font la même démarche que Didier : sur les vêtements, sur les loisirs, sur les vacances… Ancienne auxiliaire de vie, madame B. a travaillé toute sa vie sans période de chômage, mais avec sa pension de 800 euros et un loyer de 400 euros, « la vie est dure » : « J’ai une calculette dans la tête. Tous les jours, je fais le décompte de ce qu’il me reste (…). Pas d’imprévus possibles, pas de petits plaisirs non plus. » La pression est énorme. L’ancienne auxiliaire de vie se souvient de « la première fois » qu’elle est venue au Secours populaire de l’Aube. En prenant le temps de lui parler, les bénévoles l’ont « aidé à avoir moins honte ».
Au Secours populaire, les personnes aidées sont souvent bénévoles (voir, plus bas, le portrait de ZOUHRA)
Nombre de bénévoles du Secours populaire sont aussi aidés par l’association. « Certains sont même dans ses instances de direction », remarque Joëlle Bottalico, sa secrétaire générale adjointe, au terme d’un parcours où ils « ont exercé leur liberté de choix ». Même confrontées à la précarité, les personnes aidées – bénévoles ou non – se mobilisent régulièrement pour les collectes nationales lancées comme celles après le tremblement de terre au Maroc ou l’ouragan qui a dévasté Mayotte. Elles apportent aussi une petite contribution financière, pour le fonctionnement de l’association, et participent à l’élaboration des projets proposés par les bénévoles, comme les séjours de vacances. Le secteur associatif est un révélateur de la richesse dont se prive la société en tenant une partie de la population dans le purgatoire de la précarité. Réfugié venu du Congo, Rémy a « été accusé plusieurs fois de ‘‘prendre le pain des Français’’ », quand il est arrivé en France. Il est depuis devenu responsable de l’alimentaire à la fédération de l’Ariège.

Vivre au jour le jour avec les aides sociales et les stigmates qui y sont attachés représente un déni de dignité et une immense souffrance : toutes les études confortent les témoignages recueillis en ce sens par les bénévoles Cette souffrance, ce déni, cette honte expliquent pour beaucoup qu’une grande partie des personnes éligibles à l’aide sociale n’y font pas appel. L’Observatoire des non-recours aux droits et aux services de l’université de Grenoble évalue que 800 millions d’euros de prestations ne sont pas versés par manque de demandes de Complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C) et à 4,7 milliards d’euros le montant d’allocations supplémentaires que devraient verser les Caisses d’allocations familiales.
De même, l’Aide médicale d’Etat est sous le feu de l’actualité ces derniers mois alors que 35 % de ses ayants droit ne la demandent pas. De son côté, le ministère des Solidarités estime qu’un retraité sur deux éligible au minimum vieillesse ne le réclame pas, faisant une croix sur 1 milliard d’euros d’allocations, et qu’un tiers des personnes qui pourraient percevoir le RSA y renoncent (3 milliards de manque à gagner). La réforme en cours risque de décourager un plus grand nombre encore. « Ce que l’on voit dans les autres pays comparables à la France, la mise sous condition du versement d’allocations augmente surtout le non-recours », déplore Guillaume Allègre, économiste à l’OFCE pour qui : « Beaucoup de gens vont se dire qu’il vaut mieux s’abstenir par peur d’entrer dans un processus administratif arbitraire. » Ces dernières années, les contrôles tatillons se sont multipliés sous prétexte de faire la chasse à une fraude qui reste ultra-marginale
Plus simple de faire éclater le noyau d’un atome qu’un préjugé
On est loin des privilégiés profitant du système, « des maximisateurs de profits » – selon la formule iconoclaste de l’économiste Christian Saint-Étienne. Ce soupçon perpétuel repose sur la croyance du « quand on veut, on peut » : il suffirait de « traverser la rue » pour trouver du travail. Alors qu’il n’y a tout simplement pas suffisamment de créations d’emplois pour fournir immédiatement du travail aux 5,5 millions de chômeurs des catégories A, B et C ; sans parler des près de 2 millions d’allocataires du RSA (catégories D,E et les nouvelles F,G créées par la réforme). La constitution de l’État social au milieu du 20e siècle a prouvé que la pauvreté est régie par un cadre collectif dont les déterminants sont le nombre d’emplois disponibles, les niveaux de salaires, l’ampleur de la protection sociale et des services publics ou encore le nombre de professionnels de l’action sociale…
Les études montrent que la quasi-totalité des personnes privées d’emploi souhaitent reprendre un travail. Au Secours populaire de Reims, à Noël 2018, Vanessa était venue chercher des jouets pour son fils et sa fille qu’elle élevait seule avec un RSA. La jeune femme confiait sa hâte de retravailler en boulangerie, lorsque son garçon sera en maternelle : « C’est énervant de rester enfermée toute la journée chez soi, à passer d’une tâche domestique à une autre. » Vanessa se projetait retrouvant ses enfants après son travail, fière de leur raconter sa journée.
Sur la fraude et d’autres représentations trompeuses : voir, plus bas, l’entretien avec le sociologue VINCENT DUBOIS.
Crédits d’impôts à l’isolation ou pour l’achat d’un véhicule électrique, baisse de fiscalité pour les restaurateurs, subventions à l’apprentissage, etc. La société apporte de l’aide à tous ses membres, même en dehors des crises comme en 2020 ou le sauvetage des banques en 2008. A travers le thème de l’« assistanat », seule celle aux plus pauvres est vilipendée au prétexte d’un manque de volonté des individus concernés. Une croyance qui vient tout droit d’époques où il était admis que la Terre était forcément le centre de l’univers et que les ravages de la peste étaient la punition des pécheurs…
Olivier Vilain
_____________________________________________________________
REPORTAGE

Zouhra, battante au grand cœur
Portrait. Il y a vingt ans, Zouhra, en prise avec une grande précarité, franchissait les portes du Secours populaire pour demander de l’aide. Aujourd’hui, elle est un des piliers de l’équipe des bénévoles de l’antenne de Fenouillet, près de Toulouse. Le chemin de son émancipation a également conduit cette mère de quatre enfants vers d’autres engagements.
Le vent vif fait claquer le drapeau de l’oriflamme du Secours populaire et ployer son mât comme un saule. Zouhra, quant à elle, se tient droite, large sourire, devant la porte du local de l’antenne de Fenouillet. Il est 9h30 ce vendredi et la petite équipe s’active déjà : cet après-midi, la permanence d’accueil et le libre-service vont recevoir, comme chaque semaine, les personnes en difficulté de la commune. Ce sont les vacances scolaires mais Zouhra chasse l’information d’un geste aérien : « La solidarité ne prend pas de vacances ! ». Elle se hisse sur un tabouret et dispose avec soin les pots de confiture sur une étagère, afin que les étiquettes soient bien visibles. « C’est plus beau comme ça », dit-elle avec satisfaction.
Tout près, Sylviane arrange les cagettes de fruits et légumes bios et locaux. Nanou agence l’accueil : café, petits gâteaux, chaises de couleur disposées le long du mur de la pièce d’entrée ; rangement du bureau où elle recevra, dans la confidentialité, les personnes tout à l’heure. Les rayons sont emplis de produits alimentaires – primeurs, frais ou en conserve – ainsi que d’hygiène. Les familles vont être contentes d’avoir du choix ! », s’enthousiasme Zouhra. « Ici, c’est comme un vrai magasin, il ne faut pas que ça fasse pauvre. Il faut que ce soit… [elle cherche le mot avec soin] digne. »
« J’essaie de donner des conseils, avec mes mots simples. »
Vers 11h, les trois amies font une courte pause. Un café vite avalé, le planning de l’après-midi qu’on balaie du regard – une douzaine de familles sont attendues, sans compter les urgences –, on parle de Trump, du monde « qui va mal ». On évoque telle famille, qu’il « faut absolument faire partir en vacances, ça fait si longtemps » ; on déplore la solitude de telle personne âgée – « on ira passer la voir » ; on est heureux pour madame M. qui a enfin retrouvé du travail. On rit aussi, beaucoup. Comment s’y prendre pour que les hommes repartent avec des légumes ? Faut-il donner des bonbons aux enfants ? On savoure à l’avance la joie qu’apporteront aux mamans ukrainiennes les choux et les betteraves qu’elles aiment tant cuisiner – en bortsch ou en saumure – et qui leur rappelle leur pays lointain.
Zouhra se remet au travail. « Je me mets à la place des familles et je veux qu’elles se sentent respectées, considérées », précise-t-elle, comme s’il fallait justifier l’attention qu’elle porte à chaque détail. Zouhra sait parfaitement de quoi elle parle : il y a vingt ans, quand elle a franchi les portes du Secours populaire pour la première fois, c’était pour demander de l’aide. « Quand j’accueille une famille au libre-service, je me souviens toujours de la première fois que je suis venue, des sourires qui m’ont fait tant de bien. Le Secours m’a appris que quand tu souris à quelqu’un, tu le mets en confiance et, alors, il peut te parler. Et s’il se confie à toi, alors tu peux l’aider. »

C’était l’hiver 2005. Elle arriva à Toulouse avec son mari, leur premier enfant qui grandissait dans son ventre et quelques vêtements entassés dans leur R5. Le premier soir, la neige se mit à tomber sur la ville et malgré le dénuement extrême qui était le sien, Zouhra se sentit heureuse : au Maroc, elle n’avait jamais vu la neige. « J’ai décidé de quitter mon pays natal car j’y avais vécu des choses horribles », lâche-t-elle. Il lui est toujours difficile aujourd’hui de parler de ce qu’elle a vécu enfant : la pauvreté, le bidonville, l’abandon, l’esclavage, la violence quotidienne, les viols, l’absence absolue de tendresse. « Jusqu’à mes 18 ans, je n’ai vécu que des sévices, du mépris et des insultes », résume-t-elle la gorge nouée. Son histoire, elle l’écrira finalement, comme on se déleste d’un poids trop lourd pour continuer d’avancer, dans un livre intitulé Ma mère m’a donnée [*].
« Avant d’écrire mon histoire, je n’en parlais jamais à personne. C’étaient les larmes qui parlaient à ma place ! », confie-t-elle. En France, elle avait d’abord retrouvé son époux Abdel à Montpellier où il vivait – « mon mari, je l’ai choisi ! » –, mais la tristesse demeurait si puissante qu’elle avait ressenti le besoin de repartir de zéro. « Il fallait que je laisse derrière moi la Zouhra d’avant et que je change de peau. Comme une mue. Que je trouve un endroit où je ne connaîtrais personne, qui ne serait qu’à moi. On a choisi Toulouse, le nom me plaisait bien ! ». Les premières semaines dans la Ville Rose, Zouhra et Abdel dormirent dans leur voiture, affrontant le faim et le froid, jusqu’à ce qu’ils trouvent un appartement après quelques séjours en foyers d’hébergement. C’est à cette époque de grande précarité que s’opère la rencontre avec le Secours populaire, qui aide d’abord le couple à se nourrir.
« Si on tombe, ce n’est pas la fin. On se relève, on essuie ses larmes et ses genoux, et on avance. »
« L’aide alimentaire, je comprends aujourd’hui que ce n’était pas ce qui était le plus important, analyse-t-elle. Ce dont j’avais besoin plus que tout, c’était de parler, faire des rencontres. Quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas français, je ne faisais que pleurer. Je n’avais pas confiance en moi, j’avais peur des humains. » Zouhra conte son histoire devant une affiche du Secours populaire, dont elle est bénévole depuis plus de dix ans, où est inscrite la devise « Tout ce qui est humain est nôtre » ; on entrevoit l’immense chemin parcouru. A chaque étape de son émancipation, le Secours a été là – le premier appartement, le premier enfant, le premier travail. Les liens qu’elle y a tissés lui ont donné de la force et de cette confiance qui lui faisait tant défaut.
De personne accompagnée, Zouhra devient bénévole, « comme une évidence ». « Avant moi, il y a eu mes enfants. Tous ont été bénévoles au sein du mouvement “Copain du Monde”. Je suis très fière d’eux. » Ils sont quatre garçons. Issam, 18 ans, engagé au Secours populaire de Toulouse auprès des sans-abri, sourit : « Ma mère, c’est une battante, s’il y a des obstacles, elle ne lâche pas l’affaire. » Son petit frère de douze ans, Amir, confie quant à lui : « Elle est attentionnée et elle prend soin de tous les enfants. Je veux dire : nous, ses propres enfants, mais aussi tous les enfants qu’elle rencontre. » Son bénévolat au Secours populaire, mais aussi au sein de l’association Femmes du monde dont elle est vice-présidente, ainsi que son mandat de conseillère municipale à la mairie de Fenouillet, emplissent ses enfants de fierté. « On se demande comment elle arrive à faire tout ça », s’amuse Issam.

Il est 14h, Zouhra s’est absentée pour son travail d’aide à domicile. Elle revient de chez une des sept personnes âgées qu’elle accompagne, pour faire leurs repas, un peu de ménage, la toilette, « mais surtout apporter une présence, échanger des petites nouvelles, leur montrer qu’elles comptent et qu’on s’intéresse à elles. Ça contribue à ce qu’elles gardent de l’espoir, de la joie ». Les premières familles arrivent et les lieux s’animent tout à coup. Le ballet tant répété de Nanou, Sylviane et Zouhra se déroule avec simplicité et grâce, dans l’exiguïté des locaux qui paraissent accueillir, cet après-midi-là, le monde entier. Hala a apporté pour les bénévoles du pain libanais, du zaatar et des manouchés [**]. Depuis quelques mois, elle est à nouveau soutenue par le Secours populaire, après plusieurs années où elle parvenait à se débrouiller seule. Sa petite fille, qui porte le même prénom qu’elle, l’accompagne.
Elle s’est installée sur le chariot de courses et ouvre des yeux immenses sur le petit escargot qui surgit d’une salade, enserrant comme un trésor la licorne mauve que lui a offerte Zouhra. Les deux femmes se connaissent bien : elles étaient voisines de palier il y a longtemps. « J’ai même gardé ses garçons ! », se souvient Hala. Elle peine à soulever son sac de courses – les légumes et le lait, qui lui manquaient, pèsent leur poids. « Nous les femmes, on est courageuses, c’est pour ça qu’on va au paradis ! », lance Hala, provoquant le rire général. Dont celui d’Émilie, venue avec l’aînée de ses trois enfants, Kim.
« Je repars avec un plein de courses et le sourire de Zouhra. »
« Elle avait envie de m’accompagner, je lui dis toujours qu’ici, tout le monde est gentil », souligne la maman. Tandis que Sylviane l’accompagne dans les rayons, Zouhra discute avec l’adolescente et lui parle de « Copain du Monde ». « Viens nous rejoindre, il y a des jeunes de ton âge, tu pourras aider et passer de bons moments ». Marché conclu : Kim repart avec une imposante laitue – « Je vais pouvoir faire mon plat préféré, une salade César ! » et un flyer qui présente « Copain du Monde ».
Pierre Lemarchand

_____________________________________________________________
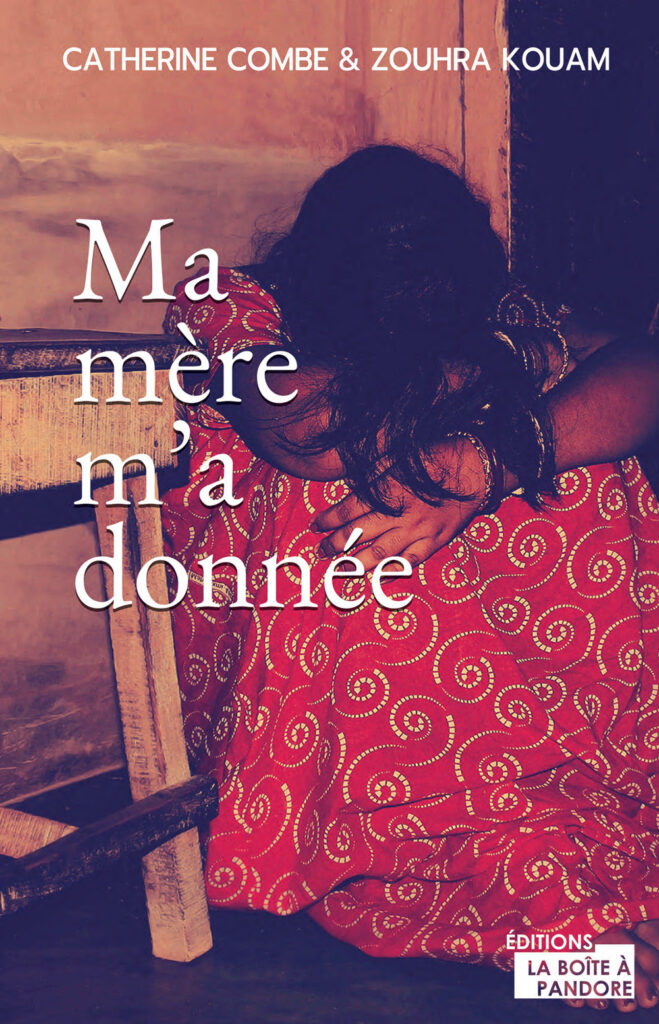
[*] Zouhra Kouam & Catherine Combe. Ma Mère m’a donnée (La Boîte à Pandore, 2022).
.
[**] Le zaatar est un mélange d’épices utilisé dans la cuisine levantine. Le manouché est un pain rond libanais, imbibé d’huile d’olive et saupoudré de zaatar.
_____________________________________________________________
PAROLE D’EXPERT

« La stigmatisation augmente le non-recours »
.
VINCENT DUBOIS, sociologue
ENTRETIEN. Professeur à l’Institut d’études politiques de l’Université de Strasbourg, Vincent Dubois a consacré 20 ans à des recherches sur l’organisation concrète du système de prestations sociales (1). Il revient sur le glissement, et sur ses effets, du discours public qui n’évoque plus au sujet des pauvres que des fraudeurs, des ‘‘assistés’’, plutôt que des ayants droit, des citoyens envers qui la société a une dette.
D’où viennent les termes « assistés » ou « assistanat » et quelles sont leurs fonctions ?
Ils désignent les pauvres en des termes extrêmement anciens renvoyant aux mécanismes d’assistance qui existaient avant la création de l’État social. ‘’Assistés’’ et ‘‘assistanat’’ traduisent une attitude double à leur égard : l’aide est restreinte aux pauvres « qui le méritent » et s’accompagne d’une punition à l’encontre de ceux qui sont perçus comme déviants de l’ordre social (2). Cette vision duale et péjorative est présente dans les débats sur l’aide accordée aux pauvres dès le 19e siècle. Ainsi dans Mémoires sur le paupérisme (3), Alexis de Tocqueville met en garde, en 1835, contre les systèmes d’aide sociale qui inciteraient, selon cet intellectuel libéral et conservateur, à la paresse, à l’oisiveté, à l’ivrognerie… Tocqueville et ses pairs estiment que la protection sociale doit être réduite à un système d’assistance fonctionnant sur le mécanisme de la charité privée de la part des riches. L’aide ainsi reçue est censée fonder une relation d’obligé à bienfaiteur, faire naître un lien, une reconnaissance des pauvres à l’égard des donateurs, alors que l’assistance publique, anonyme, ne conduirait pas à un sentiment de redevabilité et produirait des « assistés » sans lien social ni obligation morale.
Le système de protection sociale universelle se distingue de la charité privée ?
C’est une organisation sociale tout à fait opposée aux mécanismes anonymes et automatiques de l’assistance pensée comme un système de protection sociale universelle, qui provient du constat que la pauvreté est inhérente à la vie collective et n’est pas réductible à la responsabilité individuelle. La pauvreté doit à ce titre être socialisée, prise en charge par la collectivité.
Les discours sur les abus des pauvres ont-ils ne serait-ce qu’un rapport avec la réalité ?
Il faut bien voir que la fraude fiscale est bien supérieure à la fraude sociale. De l’ordre d’au moins 40 fois. On pourrait en douter quand on compare l’inflation des discours sur la fraude sociale ou la transformation des organismes de prestations sociales en systèmes de contrôle des allocataires et même la hausse continue des condamnations pour fraude sociale. Alors que le nombre de condamnations pour fraude fiscale ne cesse de baisser, si bien que les deux courbes se sont croisées dans les années 2010 (4).
L’augmentation des poursuites pour fraude sociale vient surtout de la hausse des contrôles, avec des outils toujours plus sophistiqués, plus ou moins automatisés, avec des algorithmes dont l’effet discriminant à l’égard des plus précaires a été démontré. Depuis 2005, les organismes sociaux sont dans l’obligation de poursuivre quand leurs contrôles identifient des fraudes. Mais, là encore, il faut constater qu’une partie d’entre elles était définie auparavant comme des ‘‘erreurs’’, des ‘‘oublis’’, donc sans intentionnalité. Le retard de la déclaration de la mise en couple est typique de ce changement de classification. Au début d’une relation, la mise en ménage se fait sans vraiment savoir si le couple va perdurer. L’instabilité de la situation pousse les couples à temporiser, d’autant que la déclaration entraîne une révision des prestations. La CAF classera la situation en fraude si elle identifie une absence de signalement au bout de quelques mois. La logique des couples est pourtant toute différente.
Quels sont les effets sur les pauvres de leur stigmatisation ?
Outre la recrudescence des contrôles, la stigmatisation débouche aussi sur l’individualisation des prestations sociales, faisant appel à une foule de paramètres pour ajuster chaque prestation à chaque situation. Cette mesure réduit les ayants droit à de simples récipiendaires d’une charité publique, comme s’ils étaient coupables d’être au chômage. Ce néo-paternalisme typique des politiques néolibérales a pour effet d’attiser la concurrence entre les membres des fractions précarisées des classes populaires. Cette concurrence forcenée a pour objet de ne pas sortir de la catégorie des « pauvres méritants », y compris en n’ayant pas recours aux aides sociales destinées normalement aux travailleurs qui alternent emplois précaires et absence d’emploi.
Cette intensification de la compétition, dans un contexte où leur existence dépend largement du versement des allocations sociales, explique facilement la perméabilité des classes populaires aux thèses présentant les pauvres comme des fraudeurs, mais à condition de cibler des catégories situées encore plus bas sur l’échelle sociale, comme la figure de l’étranger ou celle de la mère célibataire à la vie réputée dissolue…
Propos recueillis par Olivier Vilain
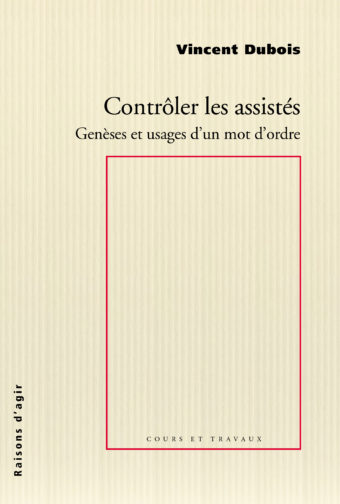
(1) Contrôler les assistés. Genèses et usages d’un mot d’ordre, Raisons d’agir, 2021.
_ La vie au guichet. Administrer la misère, Points-Seuil, 2015.
.
(2) Lire La potence ou la pitié. L’Europe et les pauvres du Moyen-Age à nos jours, Bronislaw Geremek, Gallimard, Paris, 1987.
.
(3) Mémoires sur le paupérisme, Alexis de Tocqueville, Paris, 1835.
.
